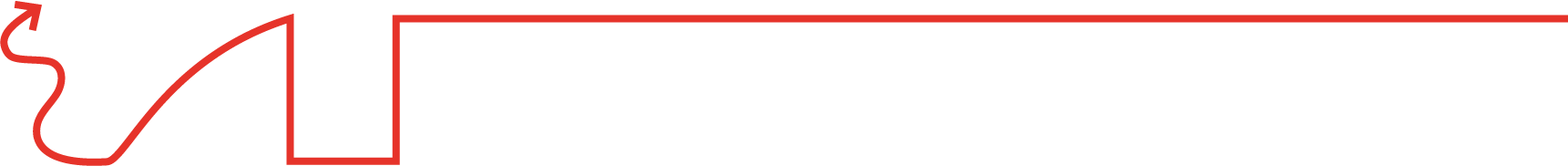Dans le cadre de notre série urbanisme sous confinement, nous avions interrogé, le 7 mai dernier, Emma Vilarem. Docteure en neurosciences cognitives, elle a co-fondé [S]CITY en 2019, agence collaborative de conseil et d’études associant expertises urbaines et comportementales. Notre échange poursuit le dernier article de notre série, qui évoquait notamment l’élargissement de l’enjeu de la résilience à la santé des urbains.
– Comment est-ce que les sciences du cerveau et du comportement mettent en évidence le rapport ville-santé ? Y a-t-il des thématiques particulières qui étayent ce lien ?
Les sciences cognitives démontrent que l’environnement urbain n’est pas neutre pour notre santé mentale. Nous savons qu’initialement le cerveau humain s’est développé dans des espaces naturels, il y a des dizaines de milliers d’années. Depuis, il évolue très lentement et ne s’est pas encore totalement adapté à la vie en ville, qui est récente dans l’histoire de l’Homme. Avec toutes les sollicitations auxquelles il est soumis, l’individu peut vivre la ville comme une adversité et cela peut avoir un impact délétère pour sa santé mentale et physique. En effet, nous constatons que la ville accroît le risque de développer certaines pathologies liées notamment aux pollutions, mais aussi au phénomène d’isolement social, aux conditions de vie dans certains habitats précaires, etc.
Cette période de confinement a révélé d’autant plus ce lien entre vie urbaine et santé mentale. Si nous remarquons que les humains ont une forte capacité d’adaptation – nous avons su adapter nos modes de vie en quelques jours pour respecter les consignes sanitaires – il ne faut cependant pas sous-estimer les dommages collatéraux de ce confinement. L’humain reste une espèce à dépendance sociale : les contacts sociaux et physiques ont une très forte incidence sur la santé et l’espérance de vie. Or ce capital social[1] peut être malmené dans des contextes de crises comme celle-ci.
– À l’annonce du confinement, en mars 2020, plus de 15% des citadins ont quitté l’Île-de-France. Comment est-ce que les sciences cognitives peuvent expliquer ce phénomène ?
Dans un contexte anxiogène, de nombreuses données démontrent que l’humain recherche l’affiliation, c’est-à-dire la présence des proches et de la famille avec l’idée de créer une unité pour lutter contre le danger. Nous savons également que l’exposition à la nature a un impact très positif sur notre cerveau qui fonctionne et se restaure plus facilement dans un environnement naturel. Les sciences cognitives suggèrent donc que ce mouvement pourrait au moins répondre à deux motivations : le besoin d’affiliation et le besoin de nature.
Dans nos villes denses, il nous est difficile de retrouver ces deux forces : les espaces verts et naturels sont rares et les tissus sociaux plus diffus. Il a été démontré que, paradoxalement, la densité peut favoriser l’isolement social. Il est donc important d’interroger la densité urbaine en ce qu’elle peut offrir de désirable aux individus, à la fois en termes d’espaces verts, et de liens sociaux qui renforcent la résilience dans ces contextes de crises.
– Après huit semaines de confinement, quelles sont les leçons que vous tirez de cette expérience pour les villes, et comment envisagez-vous la résilience urbaine ?
Il faudra sans doute du temps pour prendre la mesure de l’impact du confinement sur nos comportements, en particulier en ville. Cependant, le monde de la recherche est en ébullition et l’on peut déjà faire plusieurs observations. La première, c’est que cette crise nous aura fait prendre conscience de l’importance du tissu social : bien que le confinement a dû instaurer une distanciation sociale, le besoin de lien social a incité beaucoup d’entre nous à se rapprocher de nos voisins – c’est mon cas ! La distanciation a donc plus été physique que sociale. Au-delà du confinement, je pense que la création de lieux de rencontres, aussi bien publics que privés, devrait être un enjeu prioritaire dans les politiques publiques. J’ai dernièrement lu Palaces for the People de D. Klinenberg[2], qui évoque la résilience des populations à la vague de chaleur survenue à Chicago à l’été 1995, et qui montre que les infrastructures sociales[3] constituent autant de lieux de solidarité, qui stimulent le capital social des urbains et renforcent leur résistance aux chocs. Il est primordial de savoir créer des lieux comme ceux-là si l’on cherche à accroître notre résilience en ville.
Cela dit, la résilience des populations ne tient pas qu’à la richesse des lieux de sociabilité, car d’autres facteurs structurels entrent en jeu. Par exemple, les mobilités douces, qui favorisent les rencontres, doivent aussi guider la conception des espaces publics urbains : il faut plus que jamais croiser les approches pour que la ville puisse sous-tendre des réseaux sociaux denses et soutenants. Ce dernier point conditionne, en mon sens, la résilience des populations en ville.
Par ailleurs, l’accès nouveau au télétravail va certainement rebattre les cartes des modes de vie tolérés : dans l’après confinement, il sera difficile pour ceux qui s’étaient mis au vert de replonger dans leur trajet de métro routinier ! De nouveaux désirs individuels vont émerger dans la période qui s’ouvre, notamment concernant l’accès à la nature. Pour y répondre, de nouveaux usages restent à développer : végétaliser les espaces vacants, occuper les toits, créer des forêts urbaines denses, ouvrir ponctuellement les jardins privatifs, toujours dans le but de permettre aux citadins d’être au contact de la nature.
– À travers votre connaissance des paramètres qui influencent significativement notre santé, voyez-vous des manières dont l’urbanisme et l’architecture peuvent rendre la ville moins nocive pour les urbains ?
Oui, la recherche a déjà identifié que plusieurs aspects de la ville et de l’habitat contribuent à notre bien-être : par exemple, l’exposition à la lumière naturelle directe influence fortement notre humeur et nos rythmes circadiens. Ce point souligne que l’exposition des logements, leur orientation, ainsi que la présence d’un extérieur sont autant de paramètres favorisant les conditions d’une bonne santé en ville.
Les sciences cognitives ont par ailleurs montré que la perception et la pratique de la nature en ville ont un impact psychologique positif sur notre bien-être. Les études montrent que la perception d’un espace vert n’est pas la même suivant si l’on perçoit ou non des bâtiments au-dessus de la cime des arbres. De la même manière, il a été observé qu’une heure de marche en ville est plus « fatigante » pour le cerveau qu’une heure de marche en forêt. L’accès visuel à la nature depuis les logements, ainsi que la proximité de parcs et jardins sont donc bénéfiques pour notre santé mentale.
La pratique de la marche en ville est également un facteur de bien-être, puisqu’elle augmente les opportunités de rencontre, en plus de favoriser la pratique de l’activité physique. Dans ce domaine également, les sciences cognitives peuvent éclairer la conception des aménagements : nous constatons qu’il ne suffit pas de créer des cheminements piétons en ville pour que les habitants changent leur pratique de mobilité, mais qu’il existe divers freins psychologiques qui s’ajoutent aux obstacles physiques. Notre cerveau associe rapidement espace et sensation. Si l’on veut favoriser la marche en ville, il est nécessaire de comprendre comment les individus perçoivent les espaces qu’ils traversent. Par exemple, la marche peut être perçue comme une pratique peu sécuritaire dans certains endroits et à certaines heures notamment pour les femmes – qui ont une perception sécuritaire différente de celle des hommes.
– Et pour la suite, comment travaillez-vous sur ces sujets ?
Nous œuvrons à accompagner les acteurs de l’urbain à mieux intégrer le bien-être et la santé mentale à leurs projets, en leur fournissant des recommandations issues de la recherche scientifique, mais également sur la base de recherches de terrain sur-mesure. De manière générale, nous cherchons à comprendre l’expérience des individus dans différents environnements en utilisant des outils scientifiques pour évaluer le versant subjectif de cette expérience, grâce à des entretiens par exemple, mais également le versant objectif, grâce à des dispositifs qui peuvent refléter des mécanismes automatiques et plus inconscients (tests psychologiques, capteurs physiologiques, etc.). Ce couplage donne parfois lieu à des résultats inattendus : par exemple sur une étude menée en gare, nous faisions face à des voyageurs qui ne verbalisaient pas leur inconfort, tandis que leurs marqueurs indiquaient de claires fluctuations de leur stress !
Cette approche scientifique portée avec Guillaume Dezecache et Pierre Bonnier, tous deux spécialisés dans le comportement humain et co-fondateurs, est complétée par l’expertise d’Alice Cabaret, urbaniste et co-fondatrice : grâce à sa compétence en urbanisme, nous traduisons les résultats de nos observations par des actions ou des prescriptions opérationnelles, à destination du projet urbain. Notre ambition est de porter cette approche scientifique et urbaine pour poser un autre regard sur la ville, qui puisse prendre en compte la complexité du cerveau et du comportement humain.
Interview réalisée par Manon Brault, Alexandre Murer et Suzy Plusquellec
***
Notes et références:
- [1] Pour E. Vilarem, le capital social renvoie aux différentes ressources sociales dont disposent les individus, sur lesquelles ils peuvent s’appuyer, et qu’ils peuvent mobiliser pour agir collectivement.
- [2] Klinenberg, D., 2018, Palaces for People, How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality, Polarization, and the Decline of Civic Life, New York, NY, Crown.
- [3] D. Klinenberg définit les infrastructures sociales comme « les lieux physiques et les organisations qui façonnent la manière dont les individus interagissent » : pour l’auteur, les bibliothèques, ou les réseaux sociaux comme Facebook, font partie des infrastructures sociales (Westbrook, 2019).
***
Biographie :
Emma Vilarem est docteure en neurosciences cognitives. Entre 2013 et 2017, elle a réalisé une thèse sur la manière dont le cerveau humain traite les informations sociales et pousse l’individu à agir dans les espaces sociaux. En parallèle de ses recherches, elle s’intéresse à la fabrique urbaine dès 2016, année où elle rencontre les 3 autres futurs co-fondateurs, et dirige [S]CITY depuis 2019. Le collectif porte aujourd’hui conseil aux acteurs urbains en associant ses expertises urbaines et comportementales.